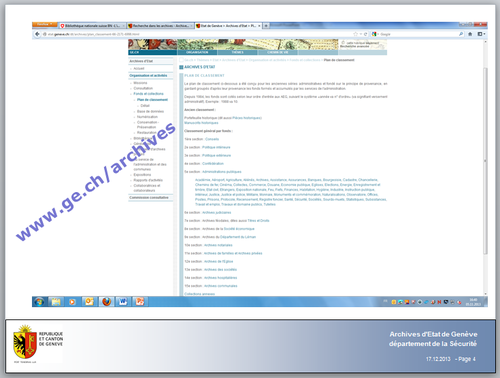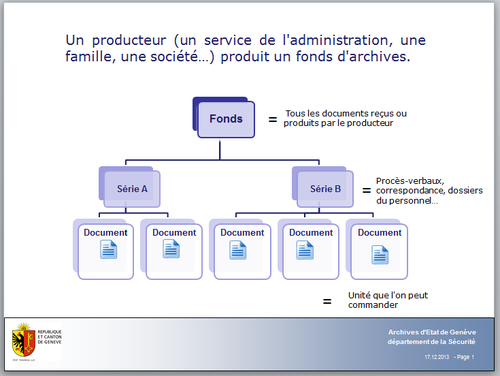par Xavier Ciana, Emmanuel Ducry et Anouk Dunant Gonzenbach
Parmi les métadonnées internes aux images se trouve notamment un certain nombre de champs (IPTC ou XMP) relatifs aux conditions d’utilisation, à savoir le droit d’utilisation qui est mis sur les images. Il faut signaler que techniquement, quel que soit le champ utilisé pour signaler des conditions d’utilisation, il n’est pas compliqué de retirer ou de modifier les métadonnées d’une image. Une métadonnée n’est donc en aucun cas une mesure technique entravant l’utilisation, la copie ou encore un filigrane numérique (watermark). Les métadonnées ne sont pas un outil destiné à limiter l’utilisation mais un moyen d’informer le public sur le statut légal d’une image.
1) Les outils à disposition sont les suivants:
• Le Copyright
Le Copyright, souvent indiqué par le symbole ©, est dans les pays de common law (droit commun) l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale. Il désigne donc un ensemble de lois, en application notamment dans les pays du Commonwealth des Nations et aux États-Unis, qui diffère du droit d’auteur appliqué dans les pays de droit civil (tels que la France ou la Belgique). Bien que les deux corpus de lois tendent à se rejoindre sur la forme grâce à l’harmonisation internationale opérée par la convention de Berne, ils diffèrent notablement sur le fond. Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit d’auteur assure un droit moral fort en s’appuyant sur le lien entre l’auteur et son œuvre.
Comme cet article concerne les images d’une institution conservant des fonds relevant du domaine public, nous n’aborderons pas plus avant dans cet article la notion du Copyright.
• Les licences Creatives Commons
Le Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif dont le but est de proposer une solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle standards de leur pays, jugés trop restrictifs. L’organisation a créé plusieurs licences, connues sous le nom de licences Creative Commons (définition Wikipedia ).
Placer une image ou une œuvre sous l’égide d’une licence Creative Commons nécessite de disposer des droits liés à celle-ci. Une institution conservant des images sur lesquelles elle ne dispose pas du droit d’auteur ne pourra pas recourir à cette solution.
Si l’on ne veut pas d’utilisation commerciale des images, il est alors possible de recourir aux Creative Commons pour définir à l’aide de quelques options très simples la solution désirée. CC-BY-NC implique par exemple de citer la source de l’image et de ne pas en faire d’utilisation commerciale. CC-BY-SA-NC revient au même, si ce n’est que l’on ajoute le devoir de partager l’image sous les mêmes conditions même en cas de transformation.
• La Public Domain Mark
La Public Domain Mark est un instrument de signalisation, créé par Creative Commons, pour « étiqueter » le domaine public en ligne. Elle a été conçue spécifiquement pour permettre aux institutions culturelles d’indiquer clairement à leurs usagers qu’une œuvre qu’elles diffusent appartient au domaine public. La marque du domaine public certifie ce statut juridique et permet donc aux internautes de réutiliser les œuvres numérisées librement en ce qui concerne le droit d’auteur et les droits voisins, y compris à des fins commerciales. Attention toutefois, la Public Domain Mark ne s’applique qu’à l’œuvre et pas à ses métadonnées. De plus, elle n’implique en rien l’absence de droits autres qui viendraient encapsuler le domaine public, tel que le droit des bases de données, ou des clauses contractuelles dans le cas d’un partenariat public-privé. La Public Domain Mark est par exemple utilisée par la Bibliothèque Sainte-Geneviève pour diffuser ses collections en version numérique sur le web, par l’Université de Clermont-Ferrand pour certains de ses fonds, ou la plate-forme MediHAL du CNRS où elle est proposée comme option aux chercheurs .
• La licence Creatives Commons zéro (CC0)
La Creative Commons Zéro (CC0) est un instrument développé par Creative Commons pour permettre aux titulaires de droits sur un objet de renoncer à leurs prérogatives pour le verser volontairement au domaine public et en autoriser la réutilisation sans aucune restriction. CC0 n’a pas été conçu à l’origine pour la diffusion d’œuvres numérisées qui appartiendraient déjà au domaine public. Il s’agissait plutôt de donner un moyen aux créateurs pour placer leurs œuvres par anticipation dans le domaine public de leur vivant, sans attendre l’expiration des droits. Les institutions culturelles peuvent aussi se tourner vers cet instrument pour la diffusion du domaine public numérisé. C’est par exemple ce que fait le Rijksmuseum d’Amsterdam. Ce dernier dispose en effet d’un espace sur son site, intitulé le Rijksstudio, sur lequel il propose plus de 125 000 chef-d’œuvres numérisés, en incitant explicitement les visiteurs à les réutiliser à leur propres fins. La licence CC0 a quelques avantages sur la Public Mark Domain. Elle peut s’appliquer aux métadonnées qui accompagnent l’œuvre. En outre, sa formulation fait qu’en renonçant à “tous les droits”, l’institution renonce donc à ces droits, tel que le droit des bases de données, qui vient parfois encapsuler le domaine public. On s’assure ainsi que l’image est effectivement libre de tous droits. Elle peut être récupérée à n’importe quelle fin, y compris commerciale. Cette option permet donc une diffusion large des images. On peut l’assortir de recommandations (code de bonne conduite, Fair Use) telles que : citer la source, de pas utiliser les images de manière offensive ou obscène, à l’exemple du RijksMuseum (voir en bas “Fair Use”).
2) Quelle protection mettre sur nos images? Nos réflexions
Une institution qui diffuse des images numérisées en ligne doit en premier lieu définir sa politique d’accès aux images. Dans le cas présent, l’approche visait à répondre à deux objectifs pragmatiques :
– faciliter l’utilisation des images par le grand public
– limiter le travail administratif pour l’institution
Du point de vue juridique, en Suisse, les lois, ordonnances et autres actes officiels, décisions, procès-verbaux et rapports émanant des autorités ou des administrations publiques ne sont pas protégés, car ils sont destinées à être publiées (Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, LDA, du 9 octobre 1992, source: Thomas Fischer, avocat, MLaw, Conférence à l’intention des archivistes sur les droits d’auteur, mai 2012). On ne peut donc pas mettre de Copyright ou poser par défaut des mentions restrictives de l’utilisation des images de ces documents.
Du point de vue philosophique, pour les images qui ne sont pas concernées par la législation ci-dessus, la question est la suivante: faut-il empêcher toute forme de réutilisation, y compris des réutilisations légitimes, et tenter de restreindre les droits, ou au contraire laisser une utilisation libre ? La question sous-tendue est: faut-il accepter que l’on puisse faire de l’argent avec des images / données publiques?
Dans notre cas concret, à savoir la mise en ligne d’images conservées dans une institution publique cantonale d’archives, empêcher toute forme de réutilisation est trop restrictif à notre sens car cela bloque par exemple les usages pédagogiques et de recherche et cela interdit également de reprendre les images pour illustrer un document, un blog ou un site. Cela est également un peu vain car en général les institutions publiques ne disposent pas des moyens nécessaires pour vérifier si les limitations sont respectées. De plus, dans le cadre de notre projet, les images sont mises en ligne pour des raisons de rapidité d’accès en format JPEG, ce qui limite la qualité d’impression et les possibilités de publication (ouvrages, affiches). L’argument de ne pas vendre des informations qui ont été financées par les impôts a également été retenu. Il est encore nécessaire de préciser que dans le cas de ces projets, il s’agit essentiellement de documents textuels, que nous ne conservons que peu d’œuvres d’art et qu’il n’y a plus de droits sur les gravures du 18ème siècle, par exemple.
La solution Creatives Commons:
Les Creatives Commons nous ont paru intéressantes par leur définition claire et accessible des droits des utilisateurs. Une approche cynique pourrait consister à dire que recourir au Creatives Commons revient à reconnaître son incapacité à faire respecter un copyright et à poursuivre les infractions en justice. Les Creatives Commons semblent toutefois bien acceptées et respectées, peut-être parce qu’elles répondent de manière relativement adaptée aux besoins des internautes
La solution Public Domain Mark et Licence CC0
Désireux d’aller jusqu’au bout de nos objectifs de facilité d’usage et de gestion, nous avons souhaité placer nos images dans le domaine public. Deux licences Creatives Commons ont particulièrement retenu notre attention : La Public Domain Mark et la Licence CCO.
Se tourner vers ces licences implique cependant d’accepter une utilisation commerciale des images par des tiers. A nouveau, il est de toute manière difficile de vérifier si les usages et réutilisations par le public respectent les limitations fixées. De plus, le service au public ainsi que la publicité entraînée pour l’institution par une large diffusion et utilisation des images sont un avantage certain. La réutilisation des images à des fins commerciales ne les empêchent pas de rester gratuitement disponibles au public sur leur serveur d’origine.
3) Choix d’une licence
Une stricte application des licences aurait voulu que nous appliquions la Public Domain Mark pour les images d’objets déjà dans le domaine public et la licence CC0 pour ceux sur lesquels subsistaient des droits que nous possédions et que nous désirions libérer. Dans un soucis de simplicité, nous avons de décidé de mettre ces deux catégories de documents sous la Licence CC0. Ce choix vise à simplifier l’utilisation des images pour les internautes et à simplifier également nos processus. Se poser la question de l’application de la Public Domain Mark ou de la Licence CC0 à la création de chaque image n’est pas possible dans le cadre de processus largement automatisés. Cette solution provoque certes une redondance pour les documents qui appartiennent déjà au domaine public mais permet de libérer les autres documents. A l’inverse, signaler des documents non libres de droits comme étant dans le domaine public aurait été erroné.
Au final nous aurions voulu pouvoir indiquer à nos utilisateurs que l’ensemble de nos images étaient libre de droits et placées sous une licence unique (CC0). Toutefois, si la très grande majorité des images mises en ligne par nos soins peuvent être placées sous cette licence, quelques séries et documents isolés devront faire exceptions. Le recours au copyright ou à des licences Creatives Commons plus restrictives sera nécessaire au cas par cas.
Ainsi, comme il n’est pas possible de définir une licence unique au niveau du site pour l’ensemble des images, l’utilisation du champ IPTC “conditions d’utilisation” permet de lever le doute et d’informer l’utilisateur des conditions d’utilisation précises d’une image parmi d’autres.
Conclusion
Il reste finalement à informer le public de l’existence du champ IPTC dont la connaissance reste confinée aux professionnels du domaine. Les internautes n’ayant pas forcément le réflexe de consulter ce champ, il sera nécessaire de rédiger également une information générale sur le site internet.
Les indications relatives au droit d’usage des images seront également complétées par quelques recommandations générales n’ayant aucune force obligatoire, telles que la mention du nom de l’institution, la manière de citer la référence ou le fait de ne pas utiliser ces images de manière inappropriée.
Les choix effectués ici ne sont pas définitifs et le débat reste ouvert. Un tel choix peut être éventuellement remis en cause par une décision juridique ou politique ultérieure. Nous nous proposons de rédiger un prochain billet sur le retour d’expérience pour compléter cette série sur les métadonnées.
Références
Pour ceux qui seraient intéressé à pousser plus loin, nous renvoyons au